La tutela accordata dall'8 della Cedu al rispetto della vita familiare implica l'adozione da parte delle autorità nazionali di misure pratiche necessarie ad assicurare al genitore l'esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli minori.
Tale obbligo va attuato cercando di trovare il corretto equilibrio tra gli interessi e diritti delle persone interessate ed in particolare di quelli superiori del minore.
Le autorità, nel lasciare così consolidarsi una situazione di illegittimità, hanno aggravato la situazione, attesa l'incidenza negativa dell'inutile decorso del tempo sulla privazione dei contatti tra genitore e figlio in età minore (nel caso di specie, le autorità giudiziarie nel procedimento avevano investito della questione i servizi sociali che tuttavia non riuscivano a portare a termine il loro mandato per irreperibilità prima e indisponibilità poi della madre affidataria della minore, giungendo dopo 5 anni soltanto alla condanna di quest'ultima al pagamento di un'ammenda) (§ 54)
La sentenza CEDU (link diretto)
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE REIGADO RAMOS c. PORTUGAL
(Requête no 73229/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2005
DÉFINITIF
22/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Reigado Ramos c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2005.
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73229/01) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Manuel Reigado Ramos (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Teixeira da Mota, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que l’absence de mise en œuvre de ses droits de visite portait atteinte à l’article 8 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 21 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1964 et réside à Lisbonne.
8. Le requérant et M.O. eurent une fille, Inês, née le 22 juin 1995. Le requérant et M.O. ne vécurent jamais ensemble et leur relation se termina lorsque l’enfant atteignit l’âge de sept mois.
9. Le 17 février 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de Cascais une procédure concernant l’octroi de l’autorité parentale (poder paternal) sur l’enfant.
10. Le 11 mars 1997, le requérant et M.O. conclurent, dans le cadre de cette procédure, un accord sur l’autorité parentale sur Inês qui fut homologué par le juge. Aux termes de cet accord, Inês était confiée à la garde de la mère mais le requérant bénéficierait d’un droit de visite. Inês était ainsi censée passer avec le requérant deux week-ends par mois et une partie des différentes périodes de vacances scolaires.
A. La demande en exécution forcée de l’accord sur l’autorité parentale
11. M.O. n’ayant pas respecté les dispositions de cet accord, le requérant introduisit, le 6 février 1998, devant le tribunal de Cascais une demande tendant à son exécution forcée. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant souligna notamment qu’entre le 11 mars et le 4 octobre 1997, il n’avait pu être avec sa fille qu’à cinq reprises et toujours en présence de la mère ou des grands-parents maternels de l’enfant. Après cette dernière date, il n’a plus revu Inês.
12. Le 18 février 1998, le requérant fut informé de ce que M.O. n’avait pas été retrouvée à l’adresse indiquée. Le 25 février 1998, le requérant indiqua au tribunal l’adresse des grands-parents maternels et, le 17 mars 1998, une nouvelle adresse de M.O., à Estoril. Toutes les lettres envoyées par le tribunal furent retournées à l’expéditeur.
13. Le 17 juin 1998, le requérant indiqua au tribunal les adresses de trois magasins dont M.O. était la propriétaire, sis dans trois grands centres commerciaux de Lisbonne et Cascais. Toutefois, elle ne fut pas retrouvée à ces adresses.
14. Le 18 septembre 1998, le requérant requit la citation de M.O. par voie d’affichage (citação edital).
15. Le 23 septembre 1998, le juge s’enquit auprès des autorités de police à l’égard de l’adresse actuelle de M.O. Le 9 octobre 1998, la police informa que M.O. résidait aux Açores. Le 14 décembre 1998, le greffe du tribunal de Cascais invita M.O. à se prononcer sur la demande du requérant.
16. Le 6 janvier 1999, M.O. intervint pour la première fois dans la procédure, par l’intermédiaire de son avocat. Elle informa le tribunal de sa nouvelle adresse, dans l’île de São Miguel (Açores). Elle souleva par ailleurs une exception tirée de l’incompétence ratione loci du tribunal de Cascais.
17. L’audition des témoins indiqués par le requérant dans sa demande initiale eut lieu les 23 mars et 6 avril 1999.
18. Par une ordonnance du 13 mai 1999, le juge demanda des renseignements sur la scolarisation d’Inês. L’école où Inês se trouvait scolarisée répondit le 14 juin 1999.
19. Le 28 juin 1999, le juge ordonna, sur demande du ministère public, la réalisation d’une enquête sociale sur la situation d’Inês. Il invita par ailleurs les parents à préciser les périodes de vacances scolaires qu’ils souhaitaient passer auprès de leur fille. Le requérant reçut notification de cette ordonnance le 3 août 1999.
20. Le 13 août 1999, l’avocat de M.O. informa le tribunal qu’il n’avait pas réussi à prendre contact avec sa cliente.
21. Le 6 décembre 1999, l’Institut de réinsertion sociale de Ponta Delgada (São Miguel - Açores), responsable pour l’enquête, informa, sur invitation du tribunal, que M.O. ne semblait pas résider à l’adresse indiquée. Le 28 janvier 2000, la police de sécurité publique de Ponta Delgada informa le tribunal que M.O. ne résidait pas à l’adresse indiquée mais à Lisbonne et qu’elle se trouva à l’heure actuelle en Espagne, pour des raisons professionnelles. Le 1er mars 2000, M.O. réitéra qu’elle habitait bien à l’adresse indiquée aux Açores et non à Lisbonne et nia avoir été en Espagne.
22. Le 21 mars 2000, le requérant indiqua de nouveau, sur invitation du tribunal, l’adresse des grands-parents maternels d’Inês.
23. Le 3 avril 2000, le juge demanda des renseignements aux autorités de police. Celles-ci informèrent, le 24 mai 2000, que Inês vivait « parfois » chez ses grands-parents maternels ; d’après sa grand-mère, Inês vivrait plutôt avec sa mère, laquelle aurait plusieurs lieux de résidence (aux Açores mais également dans les villes de Porto, Caminha et Castelo Branco).
24. Le 23 juin 2000, le requérant indiqua au tribunal qu’il était sûr que M.O. et Inês habitaient à Estoril à l’adresse qu’il avait indiquée le 17 mars 1998. Le 20 novembre 2000, la police de sécurité publique indiqua ne pas avoir réussi à retrouver M.O. à l’adresse en cause.
25. Le 21 octobre 2000, le juge sollicita, sur demande du ministère public, des renseignements concernant l’adresse de M.O. aux services d’identification civile et à la sécurité sociale. Le 29 novembre 2000, les services d’identification civile fournirent une adresse qui figurait cependant déjà au dossier de la procédure. Le 13 décembre 2000, la sécurité sociale informa que M.O. ne figurait pas dans ses fichiers.
26. Le 5 décembre 2000, le requérant indiqua au tribunal le numéro de téléphone de la maison de M.O., l’adresse d’un nouveau magasin lui appartenant, les marque, modèle et plaque d’immatriculation de sa voiture et enfin le nom et l’adresse professionnelle de son mari.
27. Le 20 décembre 2000, le ministère public demanda au juge d’ordonner la réalisation d’une enquête sociale concernant M.O. Le juge y fit droit le 5 janvier 2001. Toutefois, le 24 avril 2001, l’Institut de réinsertion sociale indiqua que M.O. n’avait pas répondu à ses convocations.
28. Suivirent plusieurs tentatives de notification à M.O., sans succès. Le 13 février 2002, l’Institut de réinsertion sociale informa le tribunal de ce qu’il renonçait à effectuer l’enquête, vu l’absence de réponse de M.O. à ses multiples convocations.
29. Le 11 juillet 2002, le requérant réitéra son souhait de rétablir le contact avec sa fille et invita le tribunal à prendre des mesures coercitives au cas où M.O. persisterait à se soustraire aux notifications.
30. Le 15 juillet 2002, le ministère public demanda au juge de condamner M.O. au paiement d’une amende en raison du non-respect des droits de visite du requérant. Il se prononça par ailleurs ainsi :
« Il faut reconnaître, s’agissant du respect des droits de visite, que seule la collaboration active des deux parents peut garantir, de manière sûre et efficace, le respect de l’accord établi. En effet, bien que l’intervention de la police puisse constituer une mesure de contrainte à adopter, elle ne semble pas efficace en l’espèce ; d’une part on ne sait pas où se trouve la mère de la mineure ; d’autre part, il faudrait recourir [à l’intervention de la police] très fréquemment, sans oublier les éventuels effets traumatisants sur la mineure. »
31. Le tribunal rendit son jugement le 3 avril 2003. Il considéra comme établi le non-respect des droits de visite du requérant par M.O. et condamna cette dernière au paiement d’une amende de 249,40 euros ainsi qu’au versement d’une somme du même montant au requérant à titre de dommages et intérêts.
B. La plainte pénale
32. Le 20 février 2001, le requérant déposa devant le parquet de Cascais une plainte pénale contre M.O. du chef de soustraction de mineur.
33. Le 19 mars 2001, le procureur adjoint chargé de l’affaire rendit une ordonnance de classement sans suites. Pour le procureur, la situation en cause ne concernait que l’inexécution d’un accord portant sur l’autorité parentale qui devait être traitée dans la cadre de la procédure civile qui était toujours pendante. Il n’y avait donc aucun indice d’une infraction pénale.
34. Le 16 mai 2001, le requérant saisit le procureur du ressort de Cascais d’une réclamation hiérarchique. Celui-ci, par une ordonnance du 24 mai 2001, rejeta la réclamation et confirma l’ordonnance de classement sans suites en cause. Il souligna que le code pénal ne couvrait plus, depuis 1995, la situation dénoncée par le requérant, de sorte que toute action pénale serait vouée à l’échec.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. Les dispositions de la loi sur les mineurs, adoptée par le décret-loi nº 314/78 du 27 octobre 1978, présentant un intérêt pour la présente affaire sont les suivantes :
Article 180
« 1. Le jugement décidera l’exercice de l’autorité parentale en fonction des intérêts du mineur ; celui-ci peut être confié à la garde de l’un des deux parents, d’une tierce personne ou d’un établissement d’éducation ou d’assistance.
2. Un droit de visite sera établi, à moins qu’exceptionnellement l’intérêt du mineur ne le conseille pas.
(...) »
Article 181
« 1. Lorsque l’un des deux parents n’exécute pas ce qui a été accordé ou décidé relativement au mineur, l’autre parent peut demander au tribunal d’ordonner les démarches nécessaires à l’exécution forcée ainsi que la condamnation du fautif à une amende pouvant aller jusqu’à 249,49 euros et au versement de dommages et intérêts au demandeur, au mineur ou aux deux.
2. Après le versement au dossier d’une telle demande, le juge convoquera les parents à un entretien ou ordonnera la citation à comparaître du défendeur afin que ce dernier soumette, dans un délai de deux jours, les observations qu’il estime pertinentes.
(...)
4. Si aucun entretien n’est convoqué ou si les parents ne sont pas d’accord, le juge ordonne la réalisation d’une enquête sommaire ainsi que toute autre mesure nécessaire, suite à quoi il décidera. »
36. L’article 249 du code pénal concerne la soustraction de mineurs. Dans sa rédaction introduite par le décret-loi nº 48/95 du 15 mars 1995, cette disposition ne s’applique qu’au mineur soustrait des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié. Dans sa rédaction antérieure au décret-loi nº 48/95, cette infraction, prévue alors à l’article 196 du code pénal, pouvait être également constituée lorsque l’auteur refusait de remettre le mineur à « celui qui légitimement le réclame ». Si une telle rédaction permettait l’incrimination de celui des parents qui ne respectait pas le droit de visite de l’autre parent (arrêt du 5 septembre 1990 de la cour d’appel de Lisbonne, dont le sommaire est disponible sur la base de données du ministère de la Justice http://www.dgsi.pt), tel ne serait pas le cas de l’actuelle rédaction, selon la doctrine (J.M. Damião da Cunha, Comentário Conimbricense do Código Penal, 1999, vol. II, p. 617).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
37. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de mise en œuvre de ses droits de visite. Il soutient que l’incapacité et le manque de diligence des autorités nationales pour faire respecter l’accord sur l’autorité parentale, doublé de l’impossibilité légale de faire mener une procédure pénale, s’analyse en une violation de cette disposition, qui se lit notamment ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
38. Le requérant reconnaît d’emblée que l’Etat dispose d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures positives à prendre afin de respecter les droits de visite des intéressés. Il estime toutefois qu’en l’occurrence les mesures prises n’ont pas été suffisantes. En effet, la situation en cause exigeait des autorités compétentes qu’elles prennent des mesures effectives. Or, ces autorités se seraient limitées à prendre des mesures bureaucratiques sans jamais avoir agi de manière à faire respecter les droits de visite du requérant, tels qu’ils avaient été convenus entre les parents et homologués par le juge.
39. Le requérant souligne que si l’emploi de mesures de contrainte n’est en général pas souhaitable, tel pourrait ne pas être le cas lorsque les autorités sont confrontées à un manque de collaboration de l’autre parent comme celui en cause dans la présente affaire.
40. Le requérant en conclut que les autorités sont restées bien en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin de respecter son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
41. Le Gouvernement admet que la situation en cause relève de la protection de la vie familiale du requérant, au sens de l’article 8 de la Convention, qui peut exiger des Etats des mesures positives destinées à garantir le respect effectif d’une telle vie familiale. Il ajoute cependant que dans la détermination de ces mesures les Etats doivent disposer d’une large marge d’appréciation leur permettant de choisir la meilleure orientation en fonction des circonstances propres à chaque cas d’espèce.
42. Pour le Gouvernement, les autorités ont pris en l’occurrence toutes les mesures non seulement raisonnables mais possibles – le Gouvernement le souligne – afin de faire respecter les droits de visite du requérant. Le Gouvernement rappelle que la Cour a estimé à maintes reprises que dans ce type de situations l’emploi de mesures de contrainte n’est pas souhaitable. En l’espèce, on ne saurait imputer aux autorités compétentes une faute de zèle, de soin ou une quelconque omission des démarches pouvant se révéler adéquates.
43. Quant à l’impossibilité de poursuivre pénalement la mère, le Gouvernement, tout en soulignant que le requérant a omis de réagir au classement sans suites en cause, demandant l’ouverture de l’instruction, souligne qu’un tel choix de politique criminelle est dans la marge d’appréciation de l’Etat. En effet, en 1995 le législateur a estimé que la situation en cause n’exigeait pas des poursuites pénales. Le Gouvernement souligne que l’absence de criminalisation de ce comportement ne veut pas dire que la personne responsable reste impunie. La législation interne prévoit ainsi que le parent fautif soit condamné au paiement d’une amende ainsi qu’au versement d’une indemnité à l’autre parent, comme d’ailleurs ce fut le cas en l’espèce.
44. En conclusion, le Gouvernement estime qu’aucune violation de l’article 8 ne saurait être constatée en l’espèce.
B. Appréciation de la Cour
45. La Cour relève d’abord que nul ne conteste que la situation litigieuse relève de la « vie familiale », au sens de l’article 8 de la Convention, cette disposition trouvant donc à s’appliquer en l’espèce.
46. Comme l’a Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux (X. et Y. c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A nº 91, p. 11, § 23). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49).
47. L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ce principe comme s’appliquant aussi à des affaires comme celle-ci où le transfert provisoire de la prise en charge trouve son origine dans un accord entre particuliers (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55).
48. La Cour rappelle que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures à cette fin n’est pas absolue car il arrive que la réunion d’un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps avec d’autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement, et requière des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituera toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (voir Hokkanen précité, § 58 et Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 56, 23 juin 2005).
49. Se penchant sur la présente espèce, la Cour note d’abord qu’un règlement amiable est intervenu entre le requérant et M.O. le 11 mars 1997 aux termes duquel Inês était confiée à la garde de la mère, le requérant bénéficiant d’un droit de visite deux week-ends par mois et une partie des différentes périodes de vacances scolaires. Toutefois, les termes de cet accord n’ont pas été respectés par M.O., raison pour laquelle le requérant a cherché l’assistance des autorités judiciaires afin de le faire respecter, comme la législation interne lui en donnait la possibilité.
50. Après l’introduction de la demande en exécution forcée, le 6 février 1998, le tribunal a pris plus de dix mois, jusqu’au 14 décembre 1998, pour prendre contact avec M.O. La Cour souligne à cet égard que s’il est vrai que l’on ne saurait spéculer sur l’exactitude des adresses indiquées par le requérant au tribunal de Cascais, celui-ci aurait pu prendre d’autres mesures, y compris auprès des autorités de police, afin de trouver M.O. dans un délai moins long.
51. Par la suite, le tribunal a ordonné la réalisation d’une enquête sociale sur les conditions de vie de M.O. et de l’enfant. Cependant, aucune enquête n’a eu lieu, M.O. n’ayant jamais répondu aux convocations de l’Institut de réinsertion sociale.
52. La procédure d’exécution forcée s’est ainsi étendue sur cinq ans et un mois, la presque totalité de cette longue période consistant dans les tentatives du tribunal de localiser M.O. et de lui notifier les différents actes de procédure.
53. La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont, en effet, en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées. En outre, comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat. Toutefois, force est de constater que les autorités sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles : c’est en vain que l’on chercherait une quelconque suggestion ou proposition du ministère public ou du tribunal lui-même afin d’essayer de réunir les intéressés ou d’impliquer activement des travailleurs sociaux dans la résolution du problème. Les autorités ont ainsi failli à leur devoir de prendre des mesures pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération, tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant (voir Zawadka précité, § 67).
54. Au contraire, le déroulement de la procédure fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements aux autorités de police ou à d’autres organes administratifs, sans que l’on ait sérieusement songé à trouver une solution concrète au problème soulevé par le requérant. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de facto accomplie au mépris des décisions judiciaires, alors même que le simple passage du temps avait des conséquences de plus en plus graves pour le requérant, privé de contacts avec sa fille en bas âge. La Cour rappelle à cet égard que le requérant a pu voir sa fille pour le dernière fois le 4 octobre 1997, alors qu’elle n’était âgée que de 2 ans, et que cinq ans et un mois ont encore été nécessaires au tribunal de Cascais pour rendre sa décision du 3 avril 2003.
55. Certes, le Gouvernement le souligne, l’impasse est due surtout au manque de collaboration de M.O., qui a réussi à se dérober à la presque totalité des notifications des actes de procédure. Cependant, un tel manque de coopération ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. Or, la procédure d’exécution forcée n’a débouché que sur la condamnation de la mère d’Inês au paiement d’une amende modique et au versement d’une indemnisation dont le montant est assez modeste.
56. Quant aux allégations du requérant portant sur l’impossibilité de faire suivre une plainte pénale en l’espèce, la Cour rappelle d’emblée que les Etats disposent d’une large marge d’appréciation quant à leurs choix législatifs, surtout s’agissant de leur politique criminelle. La Cour ne saurait imposer ses vues à celles des Etats, d’autant que le recours à la loi pénale ne constitue pas nécessairement l’unique solution en cette matière. Il convient toutefois de rappeler qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 76, CEDH 2003-VII). L’Etat doit notamment posséder une panoplie de sanctions adéquates, efficaces et capables d’assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires.
57. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités portugaises ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter les droits de visite du requérant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
58. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
60. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui a été adressée à son conseil le 25 octobre 2004, son attention eût été attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme Fura-Sandström.
J.-P.C.
S.D.
.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA
JUGE
FURA-SANDSTRÖM
1. La majorité a trouvé que les autorités portugaises ont omis de déployer des efforts adéquates et suffisants pour faire respecter les droits de visite du requérant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. La majorité a donc conclu qu’il y a eu violation et j’ai voté contre. Voici mes raisons.
2. Quand la mère de Inês (M.O.) a refusé de respecter les dispositions de l’accord qui donnait au requérant un droit de visite ce dernier a introduit une demande tendant à son exécution forcé. Du au fait que M.O. a largement réussi à se soustraire aux notifications, le temps a passé sans que le requérant a pu revoir sa fillette âgée de 2 ans sauf a cinq reprises entre le 11 mars et le 4 octobre 1997. Après cette date il n’a plus revu Inês. Et le tribunal rendit son jugement seulement le 3 avril 2003 dans lequel M.O. fut condamné à payer une amende pour le non-respect des droits de visite.
3. La question qui se pose est de savoir si les autorités ont tout fait pour remplir leurs obligations positives vue le (manque de) résultat. Autrement dit si les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (voir paragraphe 48 de l’arrêt). A mon avis la réponse est oui.
4. Je ne partage pas l’opinion de la majorité quand elle constate que le déroulement de la procédure fait apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées (voir paragraphe 54). Je ne vois pas comment les autorités auront pu faire plus pour forcer M.O. à coopérer. Par quels moyens ? Envoyer des policiers chercher la fillette à l’école ou au domicile de sa mère ? Et si jamais Inês refusait de suivre le requérant, son père ?
5. La majorité rappelle qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention en citant l’arrêt Maire c Portugal (48206/99, paragraphe 76, CEDH 2003-VII). La majorité continue par la suite que l’État doit se doter d’une panoplie de sanctions adéquates, efficaces et capables d’assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires (voir paragraphe 56) sans donner des exemples concrets. Je suis d’accord pour ne pas donner des instructions exactes, car ce n’est pas la tâche de la Cour de le faire. Voilà où se trouve tout le problème, d’autant plus que l’affaire se distingue de Maire dans le sens que cette dernière avait des implications transfrontalières limitant la marge de manoeuvre de l’Etat qui devrait coopérer avec un autre Etat en cherchant des approches harmonisées. Dans le cas de l’espèce ces aspects ne sont pas présents.
6. Dans la matière les États possèdent une large marge d’appréciation et c’est bien ainsi. Les juges internationales ne sont pas bien placés pour donner des avis précis sur des sujets sensibles comme le droit familial. Ils sont trop loin des réalités et pas compétents dans la matière.
7. Comme la Cour ne peut pas se substituer aux autorités nationales elle ne doit pas, a mon avis, critiquer les autorités portugaises en l’espèce.
8. La Cour a rappelé à maintes reprises que l’obligation des autorités nationales de prendre des mesures à réunir un parent avec son enfant n’est pas absolue, voir par exemple et Zawadka c Pologne (48542/99, §56, 23 juin 2005). Il faut trouver le juste équilibre entre les intérêts et des droits des personnes concernées et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant. Il existe des cas impossibles.
9. Cette affaire ne porte pas uniquement sur la marge d’appréciation mais également sur les limites des obligations positives. Nous ne pouvons pas critiquer les autorités nationales dans le cas d’espèce car, à mon opinion, ils ont tout fait, même si leurs efforts n’ont pas abouti. J’ai donc voté pour la non violation.
ARRÊT REIGADO RAMOS c. PORTUGAL
ARRÊT REIGADO RAMOS c. PORTUGAL
ARRÊT REIGADO RAMOS c. PORTUGAL
ARRÊT REIGADO RAMOS c. PORTUGAL - OPINION DISSIDENTE 13
DE Mme LA JUGE FURA-SANDSTRÖM




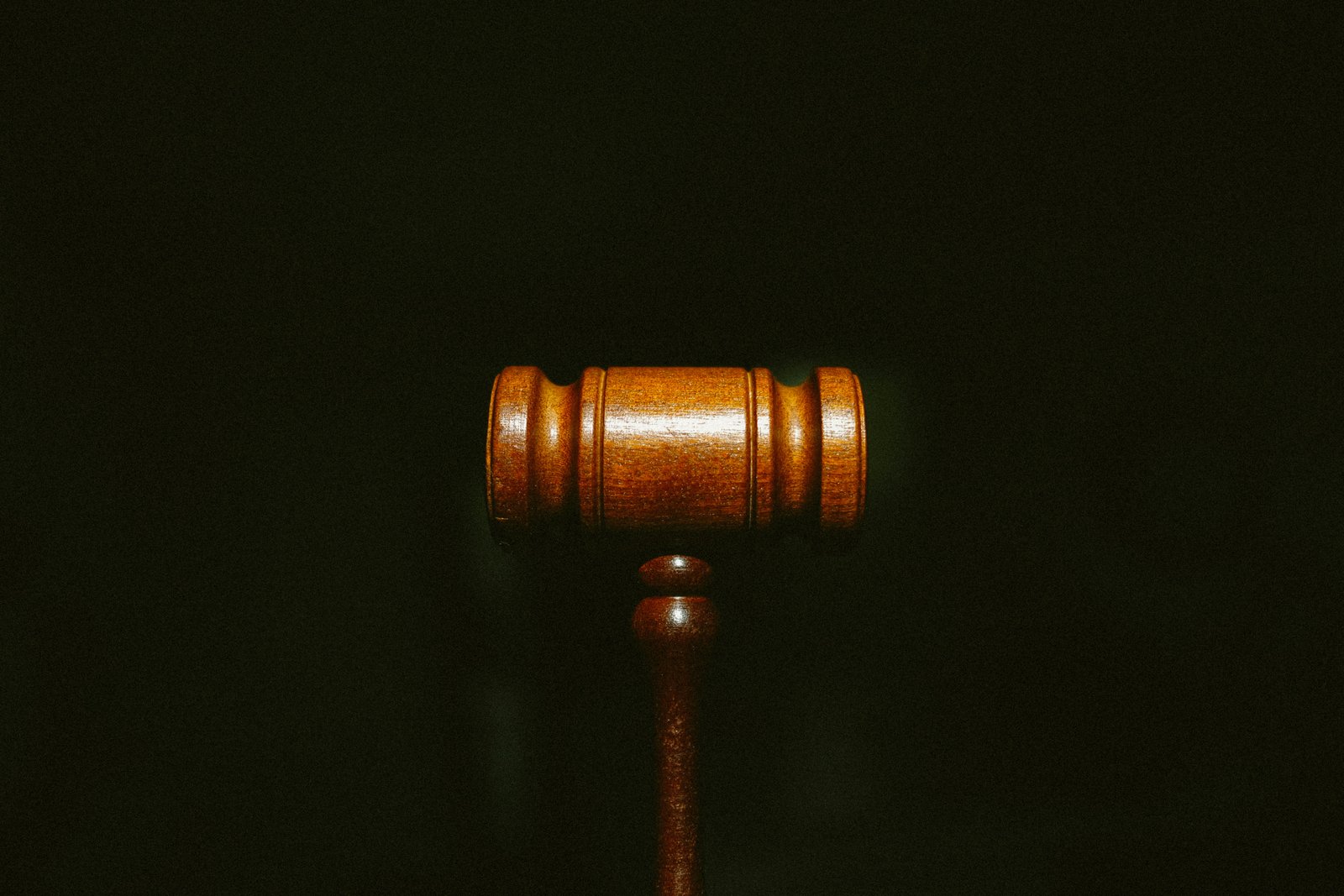

Comments